Point 1: “Equilibre” ne signifie pas “égalité”
Bonjour,
Comme convenu, voici la série sur l’importance de l’équilibre dans nos vies.
Mais avant tout, nous pouvons examiner ce que ce n’est pas.
Ceux qui vont se sentir concernés par ces propos sont peut être ceux qui en apparence sont en total déséquilibre dans leur vie: je vous entends déjà: « c’est quoi ce mythe de l’équilibre, on n’aura jamais en tant qu’être humain, assez de temps pour avoir un équilibre dans tout!!! »; ou au contraire ceux qui mettent un point d’honneur à avoir une harmonie sur tous les plans de leur existence.
En réalité, la notion d’équilibre n’implique pas de notion d’égalité. Il faut regarder plus finement les choses et observer que la notion d’équilibre sera toujours très personnelle.
Prenons l’exemple le plus simple de la conciliation travail – vie personnelle.
Certaines personnes travaillent beaucoup, et de ce fait négligent ou n’ont pas développé de sphère privée et familiale. Avoir une vie équilibrée ne signifierait pas du jour au lendemain d’avoir une vie coupée en 2 où l’on investit autant d’énergie à une sphère de sa vie qu’à l’autre. De même, s’efforcer de prendre du temps pour chaque pan de son existence peut être épuisant, et impossible à tenir à la longue.
Pour moi, l’équilibre signifie plutôt d’avoir identifié qui on est vraiment, et de quoi on a besoin dans sa vie. Parce que si on sait qu’on est très ambitieux au niveau carrière parce que l’on a une vraie mission à développer, l’équilibre sera d’avoir un minimum de vie personnelle à côté qui aide à rester ancré dans ses projets.
Si l’on rêve d’une vie conventionnelle avec une famille et que l’on s’imagine faire de nombreuses balades à vélo dans la forêt et voyager, il est évident que la vie professionnelle va être plus réduite que dans le cas numéro 1.
Bref, parler d’équilibre n’impliquera jamais que le temps doit se diviser par 2, ou qu’il faut consacrer le même temps à toutes les tâches à réaliser.
En revanche, l’équilibre va impliquer de répartir dans sa vie le temps et l’énergie dans ce qu’il y a de plus important pour soi.
Point 2: le monde entier a pour objectif de s’équilibrer
On peut se référer au cadre de l’analyse systémique quand on veut réfléchir à ce qu’est l’équilibre. Selon cette approche, le monde serait fait d’un ensemble de systèmes, eux-mêmes organisés en sous-systèmes en imbrication les uns les autres en vue d’un équilibre (à l’image du corps humain, avec les différents organes qui le composent).
Quelque soit le système que l’on étudie, les mêmes caractéristiques se vérifieraient, que l’on soit dans le monde du vivant (être humain, organisme, système solaire etc) ou du construit (entreprise, administration, …). Le système se caractérise par: une finalité, des sous-systèmes polarisés (positif et négatif), un ensemble d’interactions ayant pour but d’aboutir à l’équilibrage.
Lors de mes études en psychologie du travail, les illustrations étaient issues pour la majorité des milieux homme-machine.
Par exemple, dans le secteur industriel, les erreurs humaines peuvent avoir des conséquences désastreuses (blessures, arrêt de la production, accidents…). L’approche systémique pouvait montrer que lorsque la charge de travail augmente considérablement, les contrôleurs aériens modifient leur stratégie de traitement des avions; les conséquences pouvant être bénéfiques ou alors déboucher sur des mini-incidents, des catastrophes. En systémique, chaque comportement a une raison d’être dans le traitement de la tâche confiée, la compétence technique était autant amenée par le respect des procédures (+) que par la correction humaine devant des imprévus (-).
Il m’a fallu beaucoup de temps avant d’envisager pour la première fois la notion de système transposée dans mon activité professionnelle. Mais si on y réfléchit, les systèmes corps- esprit, ou les systèmes conscient-inconscient sont particulièrement intéressants à examiner dans le travail d’accompagnement à l’élaboration de projets professionnels, ou ou d’accompagnement à la reconversion professionnelle de personnes souffrant de maladies.
Tout d’abord, cela veut dire que tout ce qui nous arrive a du sens et intervient en faveur de notre équilibre.
Ensuite, on peut en déduire que tout ce que l’on considère comme négatif dans nos vies (maladies, accidents, empêchements, symptômes) joue un rôle important, au moins équivalent à celui des événements positifs dans cette tentative d’équilibrage global.
Point 3: Le burn out comme expression d’un état de déséquilibre
Je reprends mon histoire préférée de burn out, qui n’est ni plus ni moins l’expression d’un état de déséquilibre.
Tous les auteurs qui se sont penchés sur la question ont décrit, à leur manière, le fait suivant: il s’agit d’un processus, comprenant 1) un déséquilibre entre les ressources individuelles et organisationnelles face aux exigences de travail, 2) conduisant à des réponses de nature émotionnelle, 3) et qui provoque des changements dans les attitudes et les comportements du travailleur (Cherniss, 1980).
Dès 1974, Freudenberger , psychiatre américain décrivait l’épuisement professionnel des personnel des professions d’aide comme un ensemble de symptômes physiques et comportementaux , causé par un engagement excessif en réponse à une trop grande demande. C’est quand “nous sentons cette force intérieure qui nous pousse à travailler et à aider, et quand nous nous sentons poussés de l’extérieur à donner”. Cette force est comme « un besoin excessif et finalement utopique ».
Pour ma part, je me sentais bloquée, car, jeune diplômée, je commençais tout juste à développer les compétences requises pour mon métier (je n’ai jamais demandé d’aide et j’ai eu tort); et quand la structure a commencé à rencontrer de graves problèmes organisationnels et économiques, on nous a demandé encore plus de s’investir dans notre mission d’accompagnement et d’aide. J’avais un salaire plus important, il était demandé de la part du collectif un engagement supplémentaire pour faire tourner la boutique (condamnée, la boutique…).
Ainsi, je me suis « enfoncée » dans ce déséquilibre, et « cachée », au lieu d’envisager de manière concrète et pragmatique la réalité.
Point 4: C’est la seule façon de traiter durablement le burn out
Telle a été ma été ma conclusion, je vous laisse l’examiner à votre niveau.
J’entends par le terme « traiter » le fait de « dépasser » l’état d’épuisement professionnel. C’est à dire le fait non seulement d’être apaisé, mais aussi d’avoir retrouvé un état de compétence, de confiance sur d’autres bases plus solides de celles précédentes.
C’est aussi le phénomène décrit par Canguilhem, quand il dit qu’on est en santé quand on arrive à produire un effort permanent, qui va permettre d’aboutir à un nouvel état d’équilibre dans le milieu dans lequel nous évoluons. Vous pouvez voir de quoi je parle dans cet article ici.
Pour ma part, cette théorie correspond parfaitement à ce que j’ai ressenti: j’ai estimé que j’allais mieux quand j’ai retrouvé un équilibre de vie intéressant.
Comme je n’ai pas été diagnostiquée, je n’ai pas pris de médicaments et il m’a fallu un temps important pour sortir de ce que je pourrais appeler l’état de crise. Même le fait d’avoir été éjectée de la situation à l’origine du mal-être (licenciement économique) n’a pas été un motif suffisant d’apaisement.
J’ai l’impression de commencer à affronter les choses et à les résoudre quand je me suis trouvée dans d’autres situations de travail, me permettant de me confronter à des situations similaires.
J’adopte un autre mode de pensée et donc agis différemment.
Point 5 Les maladies nous enseignent une certaine sagesse
Les personnes qui parviennent à reconfigurer leur vie en prenant en compte les enseignements de leur maladie arrivent à un meilleur équilibre global.
J’ai l’exemple, d’une personne souffrant d’une maladie chronique, très douce, très serviable, qui en plus de son travail physique, gâtait continuellement ses collègues par des présents, et des mets variés. Elle avait la même attitude à la maison, elle faisait tout pour tout le monde (NB: ce n’est pas moi qui le dit, c’est elle). La maladie l’a obligée à s’écouter (par le biais de ses douleurs), changer de métier, et avoir une autre attitude. Aujourd’hui, quelques années plus tard, elle se sent heureuse et prend soin d’elle: 3 ou 4 sur jours /7, elle fait une activité de détente ou sportive, ce qu’elle n’aurait jamais imaginé faire auparavant. Elle aura toujours des douleurs, mais est stabilisée sur son type d’emploi et sa façon d’être. Elle est toujours serviable mais a appris à dire non quand elle ne peut pas. Car elle sait que quand elle recommence à “donner trop”, une nouvelle crise sera à prévoir.
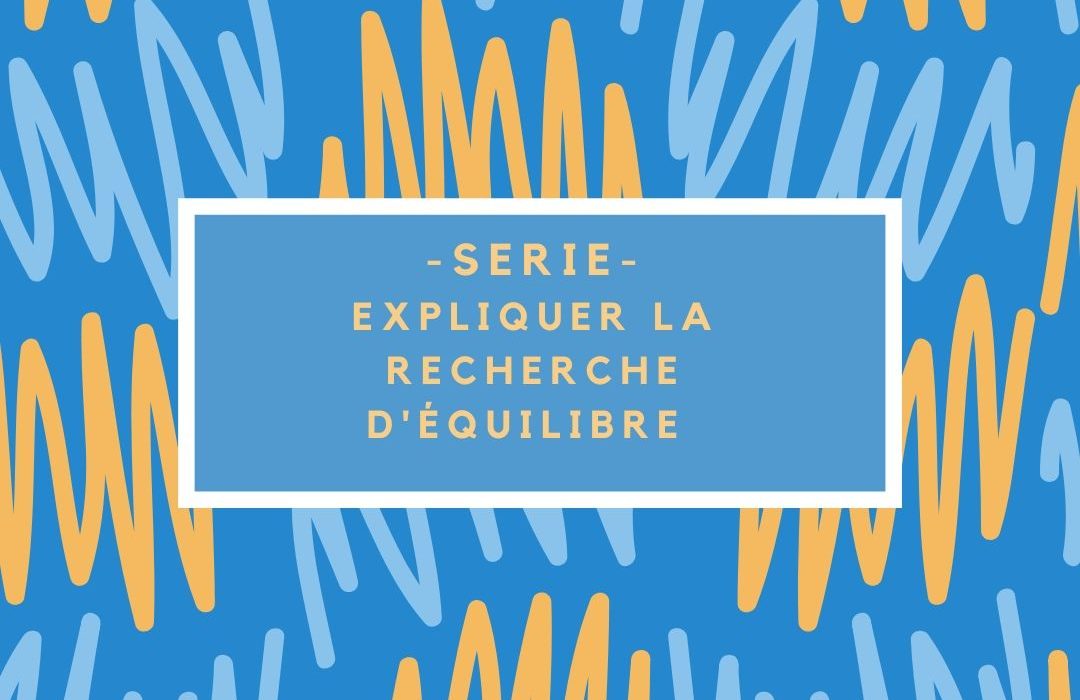
1 comment